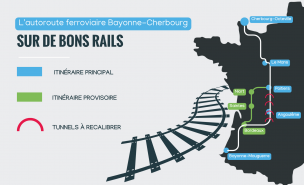On y voit des policiers enquêteurs- la police criminelle n’en est encore qu’à ses balbutiements- dont le professionnalisme est souvent bousculé par les « vices » de l’époque : alcoolisme, brutalité des interrogatoires de suspects, prégnance de l’anti- sémitisme ; les investigations de ces messieurs se mélangent souvent avec leurs affaires de cœur. On y distingue la misère crue des familles prolétaires, sombres tableaux qui évoquent Dickens et Zola. On y mesure, près de trente ans après, la profonde blessure patriotique de la défaite de 1870 et son cortège de désastres toujours présents, et aussi la force de l’anarchisme politique. De ce monde de la chair triste, de la chair malmenée, de la maternité désirée et souvent contrariée, de la filiation, des enfants violentés, l’auteur réussit un tableau lucide et vigoureux, porté par une prose directe et sèche. Illustration aussi sévère qu’attachante d’une époque où est-il regretté, « grâce à l’État de droit, la république s’enorgueillissait de protéger les faibles, surtout les enfants, et de les aider en cas de malheur. Il s’agissait de leur donner une chance de s’en sortir malgré un mauvais départ dans la vie. Ici tout le contraire… Dans cette république dévoyée, les faibles buvaient le calice jusqu’à la lie. » Et, histoire d’enfoncer le clou, on retiendra ce dialogue final entre le commissaire et la veuve d’un policier : « Avez-vous déjà entendu parler de la république des faibles, demanda le commissaire au bout d’un moment. Comme tout le monde, répondit-elle en se retournant. C’est une belle idée de mettre le droit au service des individus sans défense. Malheureusement, et croyez en ma longue expérience de femme, cette conception n’a jamais été d’actualité. »
L’Actualité du Roman Noir : La République des faibles
 La Machine à Lire
La Machine à LireL'Actualité du Roman Noir : La République des faibles