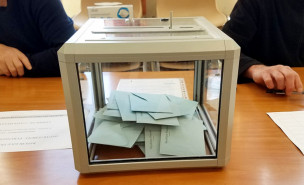Le 8 avril, le projet de loi de protection des langues régionales, dite loi Molac du nom du député du Morbihan Paul Molac, a été adopté par l’Assemblée Nationale. La loi porte sur l’enseignement de ces langues, leur dimension patrimoniale et leur emploi dans les services publics. La loi Molac aurait dû être promulguée le 22 avril dernier, mais une soixantaine de députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour étudier un de ses articles. On en parle avec Charline Claveau, présidente de l’Office Public de la Langue Occitane et conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, en charge des langues régionales.
@qui! : Selon vous, quels sont les apports du projet de loi de protection des langues régionales ?
Charline Claveau : Il y a plusieurs nouveautés. D’abord, la loi stipule de pouvoir proposer un enseignement en langues régionales à tous les élèves. C’est bien entendu facultatif, mais cela pose quand même la question des moyens. C’est ce sur quoi nous travaillons principalement : avoir des enseignants pouvant officier dans ces langues. Pour cela, deux solutions s’offrent à nous. Soit on forme des étudiants, soit on va chercher des enseignants déjà en poste qui souhaitent se former ou se perfectionner dans une langue régionale. On négocie avec les rectorats pour des congés de formations et des remplacements. Pour former les enseignants à la langue occitane, il faudrait une formation de 10 mois environ.
Deuxième nouveauté, dans le premier degré : l’enseignement immersif. Les élèves suivent le programme scolaire en langue régionale. Actuellement, c’est une forme d’enseignement qui est disponible uniquement sous forme d’expérimentation, donc compliqué à mettre en place. Pour le Basque par exemple, il y a une vingtaine d’établissements qui expérimentent le dispositif, mais le rectorat freine l’ouverture de nouvelles classes. Pour l’occitan, il n’y en a aucun. Le projet de loi actuel fait sauter le statut d’expérimentation, pour mettre en place cette forme d’enseignement dans l’école publique. C’est très positif pour nous, et c’est une disposition de la loi qui a été extrêmement débattue.
@! : Un volet fait débat, celui du forfait scolaire (participation des collectivités aux frais des écoles)…
C.C : Les établissements qui enseignent les langues régionales sont rares. Souvent il font partie d’un réseau d’écoles associatives. Ces établissements ne disposent pas systématiquement d’un forfait scolaire pour les élèves. Jusqu’à présent, il n’était pas obligatoire de trouver un accord entre la commune de résidence de l’enfant et la commune de l’établissement. Avec cette loi, ce serait systématique. Le forfait scolaire est un manque à gagner important pour le réseau associatif des langues régionales.
@! : Outre l’enseignement, le projet de loi Molac porte une dimension patrimoniale. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C.C : Les langues régionales faisaient déjà partie du patrimoine national, sans qu’elles apparaissent dans le Code du patrimoine. La loi les fait entrer dans ce Code. Symboliquement, c’est très important : nous sortons de centaines d’années de dévalorisation des langues régionales. Sous la Cinquième République, aucune proposition de loi reconnaissant les langues minoritaires n’a pu passer le seuil du Parlement, par peur du séparatisme. Les sentiments d’appartenance culturelle concernent tous les citoyens, on peut se sentir basque et français sans que ce soit dangereux.
J’ai tendance à penser que reconnaître la pluralité culturelle n’est pas excluant pour autant. Ce qui était intéressant dans le vote de cette loi, c’est que chacun des députés a évoqué sa situation personnelle et s’est dit fier de son identité régionale. Depuis la fin des années 60, un certain nombre de collectivités se sont emparées du sujet des langues régionales et les ont structurées. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons par exemple l’office public de la langue basque, celui de la langue occitane. C’est une maturité importante aujourd’hui.
@! : La loi fait également référence à l’adaptation des services publics…
C.C : Là encore, elle vient entériner des initiatives intéressantes, comme les signalétiques bilingues [l’affichage du nom des communes en français et en basque par exemple]. Jusqu’à présent, l’assise légale reposait sur une jurisprudence. La loi vient asseoir ces initiatives sur la signalétique bilingue. Pour nous, ça peut être un coup de pouce avec des partenaires potentiels. A la Région, nous sommes en train de travailler la signalétique sonore dans les TER, avec des annonces en basque ou en occitan. Jusqu’à présent, faute de disposition légale claire c’était très compliqué de mettre cela en place.
« On sort du patrimoine de musée »
@! : Le projet de loi reste donc plutôt positif, d’après-vous…
C.C : Complètement. Avec ce type d’approche, on sort du risque d’un patrimoine de musée. Le projet de loi parle d’usage de la langue, de transmission. Elle est obligatoire pour la survie de ces langues : si on n’a pas 30% d’habitants des territoires qui les pratiquent, elles vont disparaître.
@! : Certaines langues, comme le basque, sont essentiellement orales, cela peut poser des problèmes dans la transmission.
C.C : Pas forcément. Par exemple, l’occitan a longtemps été langue d’administration. On a souvent des problèmes de norme graphique unifiée. Sur le basque, vous avez une vingtaine de dialectes différents en fonction des territoires, mais un basque unifié a émergé, c’est cette langue-là qui est enseignée. Le poitevin-saintongeais est un autre exemple : une norme graphique existe, mais elle est mal appréhendée par ses pratiquants.
Nous constatons que la transmission des langues régionales passe beaucoup par les grands-parents, et c’est un phénomène de plus en plus récurrent. Si en plus nous avions la chance d’avoir pléthore d’enseignants dans ces langues, nous aurions des clés pour enseigner toutes ces variations locales… Des marseillais et des habitants du Limousin se comprennent, même s’ils parlent « leur » occitan…
100 députés de la majorité favorables
@! : Sur le vote, le projet de loi Molac a été adopté le 8 avril à 247 voix pour et 76 contre. Le gouvernement était globalement contre le projet, mais une centaine de députés de la majorité s’est prononcée en faveur de la loi Molac.
C.C : En première lecture, la proposition de loi a été extrêmement amendée, notamment par le gouvernement. En seconde lecture, les députés ont adopté le projet en votant contre les amendements du gouvernement. Quelques jours plus tard, des députés de la majorité ont saisi le Conseil constitutionnel, alors que normalement c’est plutôt l’opposition qui le fait.
@! : Cette saisine a eu lieu le 22 avril, date limite avant la promulgation automatique de la loi, comment le percevez-vous ?
C.C : C’est très étonnant. Elle porte d’ailleurs sur l’article du forfait scolaire, qui est le plus porteur de ce projet de loi pour les députés qui y sont oppsés. En Nouvelle-Aquitaine, des parlementaires du Lot-et-Garonne et de la Creuse, des zones occitanophones, font partie des 60 députés ayant demandé la saisine.
Concernant l’issue du dossier, Paul Molac se dit très confiant sur le fait que sa proposition de loi respecte le cadre constitutionnel. Sur la proposition de création d’un enseignement facultatif en langue régionale, cette notion est inattaquable. Pour les forfaits scolaires c’est plus compliqué : l’argument soulevé par les députés dans la saisine, contre l’obligation de verser un forfait scolaire pour un enseignement facultatif peut s’entendre, mais il est contradictoire lorsqu’on veut protéger les langues régionales.
@! : Y voyez-vous un message envoyé aux territoires par les députés ? Nous sommes à trois mois des débats sur le projet de loi 4D, dit de décentralisation…
C.C : Les langues régionales n’ont pas une répartition homogène sur les territoires. La notion d’égalité figure dans la devise républicaine, mais il n’y pas pas d’égalité des territoires en termes de langues régionales. A chaque fois que nous interpellons Jean-Michel Blanquer [Ministre de l’Éducation Nationale] pour qu’il mette un cadre à l’enseignement des langues régionales, il nous dit que ce n’est pas son affaire, que les typicités territoriales se voient en territoire, alors qu’à la fin c’est le ministère qui aura le dernier mot quoiqu’il arrive. En bientôt quatre ans, cette posture n’a jamais changé. Le sujet est baladé entre les ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture, alors que dans les collectivités, nous avons réussi à structurer ces langues régionales. Toujours plus de décentralisation ne peut pas faire de mal.