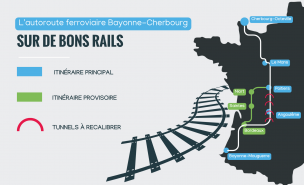Nous sommes en Provence, Angelo galope à la recherche de son frère de lait, Guiseppe. L’un et l’autre sont des Carbonari, membres d’une société secrète, qui est, pour le dire vite, en lutte contre la domination autrichienne et pour l’unité de l’Italie. On apprendra les raisons de l’exil d’Angelo : jeune colonel des hussards, il a tué un Autrichien honni, en duel au sabre, arme qu’il manie fort bien.
Le récit est tout en mouvement, le héros va, d’abord en solitaire, confronté à une épidémie de choléra qui décime les campagnes, foudroyant les malheureux qui dégorgent une sorte de pâte à consistance de riz au lait, début de leur agonie. On est dans la chaleur du mois d’août et « la lumière … était très blanche et tellement écrasée qu’elle semblait beurrer la terre avec un air épais…Dans le ciel de craie s’ouvrait une sorte de gouffre d’une phosphorescence inouïe d’où soufflait une haleine de four et de fièvre, visqueuse, dont on voyait trembler le gluant et le gras. », ce qui n’annonce rien de bon. Jeune -il a 25 ans- et intrépide, courageux et réfléchi, il affronte le danger mortel avec lucidité. Ayant appris d’un jeune médecin, qu’il surnomme affectueusement « le petit Français » les premiers gestes de soin, il les prodigue sans hésitation aux malades rencontrés. En vain, en général. Mais qu’importe, il insiste et s’acharne sur les corps aux chairs presque bleues pour les ramener à la vie. Il fait plus : dans la ville de Manosque, où il connaîtra différentes aventures, on y reviendra, il seconde efficacement, pendant plusieurs jours, une religieuse chargée des toilettes des morts.
Ce Hussard se lit donc comme une chronique en temps d’épidémie. Avec les barrages de quarantaine, établis soit par la troupe, soit par des milices villageoises. Il lui faut ruser pour passer, ou bien affronter soldats et paysans. Son art de l’escrime fait alors merveille.
Deux épisodes culminent dans la narration : d’abord le séjour à Manosque, seule ville où Angel stationne quelque temps, contraint et forcé. À peine arrivé en effet, il est accusé, voulant boire à une fontaine, de chercher à l’empoisonner et manque de se faire lyncher. Le voilà qui se réfugie sur les toits, regardant de haut l’agonie de la ville et les mouvements de foule. Tentant des incursions dans les maisons abandonnées pour se ravitailler, il tombe sur une jeune femme au « petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns » qui fort civilement lui offre du thé. Après cet échange très poli, on la perd de vue. Obligé de se confiner hors de la ville, il finit par retrouver Guiseppe dans une étonnant campement à ciel ouvert en flanc de colline où s’élabore une vie sociale très stricte. Mais ils décident de fuir à nouveau, chacun de son côté.
Rencontrant à nouveau la jeune femme de Manosque, il va rester avec elle. Ils affrontent en camarades de lutte, lui au sabre, elle au pistolet, les pièges de la route : à nouveau des confinements dans un château-prison dont il faut s’évader, des combats avec des militaires ou des villageois. Surtout le choléra, qui jusqu’ici les a épargnés, rode au plus près. Et le sentiment amoureux affleure entre Pauline de Théus (car tel est son nom, qu’elle ne délivrera que dans les derniers chapitres) et Angel. Voilà les ultimes précipités du roman à découvrir…
C’est un roman d’apprentissage, de construction et d’affermissement du caractère du héros. Ainsi Angel est contre l’oppresseur du peuple italien, il se veut esprit démocratique.
Mais cela suffit-il pour être aimé du peuple, lui l’aristocrate ? Les rencontres, les brefs dialogues avec les gens de toutes conditions l’amènent à s’interroger à la fois sur l’image qu’il renvoie de lui-même – « Les républicains ont un amour malheureux pour les princes », lui dit malignement Guiseppe- et sur sa perception des autres. L’essentiel est peut-être la recherche du bonheur, à l’image des héros de Stendhal, Giono cachant pas les emprunts. Mais en même temps, il lui importe d’avoir la position la plus juste dans les situations qu’il traverse, de se comporter selon son éthique personnelle. Le réussit-il au temps du choléra ? Au lecteur de juger.
Au fil des pages, on tombe à l’arrêt devant les somptueuses descriptions de la nature et des paysages en mouvement comme sous le pas des chevaux, des couleurs comme une mosaïque qui paverait le sol, mais aussi des oiseaux si divers (hirondelles, corbeaux, martinets, rossignols) qui se repaissent des cadavres, des nuées de papillons qui s’abattent, comme des nuages de criquets sous d’autres cieux.
Enfin, on sera attentif aux descriptions sensuelles des vivants et presque anatomiques des morts : Giono tour à tour saisit les corps, dans les scènes de beuverie, bacchanales tristes, à la manière d’un Breughel, décrit des femmes comme jaillies d’un tableau de Rubens, ou encore observe les corps abandonnés « la mort avait taillé une déesse en pierre bleue dans une belle jeune femme, qui avait été apparemment opulente et laiteuse, à en juger par son extraordinaire chevelure », comme dans une peinture de Rembrandt.